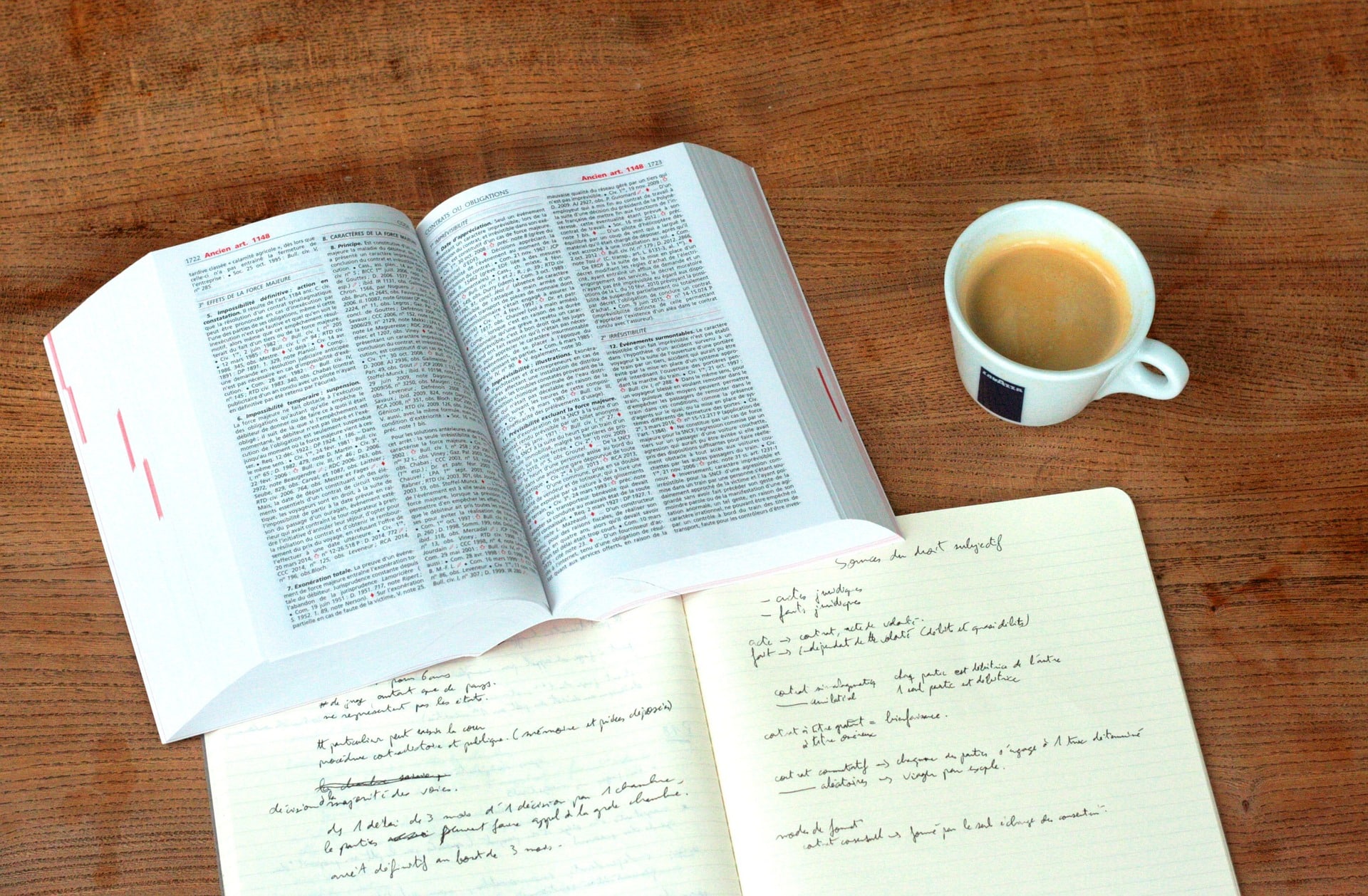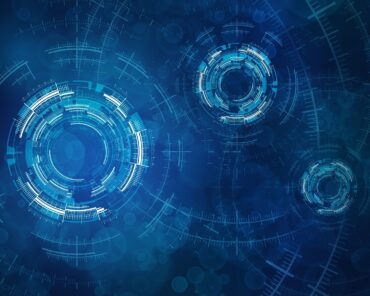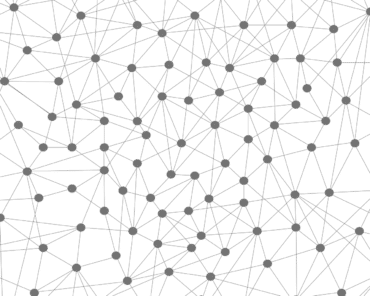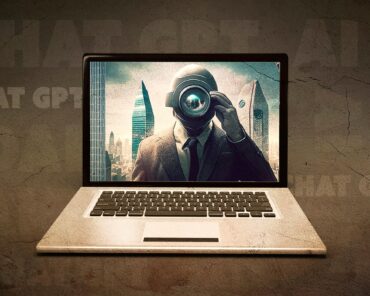L’intelligence artificielle s’impose comme un maillon essentiel des dispositifs de cybersécurité. Elle permet de détecter les intrusions, d’isoler les machines infectées et de neutraliser les attaques en temps réel. Mais cette avancée technologique est à double tranchant : les cybercriminels s’en emparent à leur tour pour lancer des offensives plus ciblées, rapides et difficiles à détecter. Ce retournement impose une réponse à la fois technique et juridique, comme le souligne une tribune publiée sur le site Incyber.org.
Entre innovation et souveraineté
Face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle, l’Union européenne déploie une stratégie fondée sur trois leviers : renforcer la réglementation (RGPD, directive NIS 2, AI Act), soutenir la recherche grâce à des programmes comme Horizon Europe, et expérimenter via des « bacs à sable » réglementaires, permettant de tester de nouvelles technologies dans un cadre sécurisé. L’objectif est de stimuler l’innovation tout en assurant une forme d’indépendance stratégique. Car dans des secteurs sensibles comme la santé, l’énergie ou la défense, utiliser des outils conçus à l’étranger – dont les paramètres et l’usage échappent à tout contrôle européen – expose les États membres à des risques majeurs, en particulier sur la question de la souveraineté des données.
Respect des droits
Ce souci de souveraineté ne saurait faire oublier un autre enjeu central : le respect des droits fondamentaux. Quand l’IA est utilisée pour surveiller, anticiper ou catégoriser les comportements, la vie privée et les libertés individuelles sont directement concernées. C’est là que le cadre juridique européen intervient. Le RGPD a posé les bases d’une protection des données personnelles. L’AI Act prolonge cette logique en imposant des garde-fous en matière de transparence des algorithmes, d’évaluation des risques ou d’encadrement des usages les plus intrusifs. L’ambition est claire : faire de l’Europe un espace d’innovation responsable, où le progrès technologique ne se fait pas au détriment des libertés publiques.
Lire aussi sur L’Essor de la sécurité : Fraude au faux conseiller bancaire : l’enquête choc sur une escroquerie de masse
Ce cadre, à la fois protecteur et incitatif, offre une première réponse aux défis de l’IA. Mais il reste à évaluer dans les faits. Ses effets ne pourront être mesurés qu’à moyen terme, en observant la façon dont les industriels s’en emparent, comment les autorités appliquent les nouvelles règles, et comment les menaces évoluent. En somme, la trajectoire est tracée, mais sa solidité reste à éprouver.