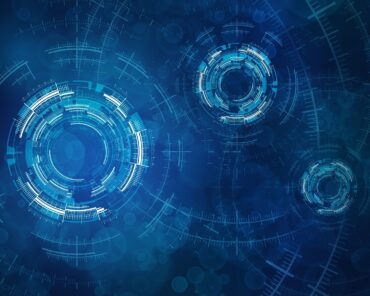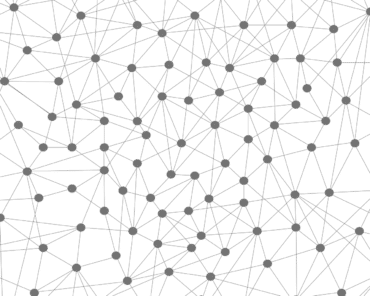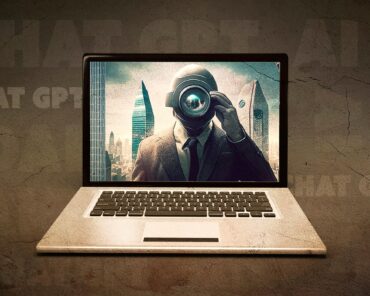Depuis sa création, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) s’attache à comprendre les mécanismes complexes des milieux marins et à promouvoir une gestion durable de leurs ressources. Présent sur toutes les façades maritimes, l’établissement public pilote des programmes de recherche de haut niveau, souvent en lien étroit avec l’État et les industriels du secteur. Ses missions couvrent un spectre large : observation océanographique, étude de la biodiversité, évaluation des ressources, développement de technologies d’exploration.
Une pression accrue sur les abysses
L’entretien met en évidence un glissement progressif, mais structurant : les grands fonds marins ne sont plus seulement un champ d’investigation scientifique ou écologique. Ils deviennent un espace stratégique, soumis à une pression croissante. Métaux rares, encroutements cobaltifères, hydrates de méthane… ces ressources attisent les convoitises. À cela s’ajoutent les impacts du changement climatique, qui fragilisent des écosystèmes encore peu connus mais essentiels à l’équilibre océanique.
« Il est désormais impératif de mieux connaître ces zones », insiste Vincent Rigaud. Outre les enjeux de connaissance, se pose la question du contrôle : qui aura la capacité technique, scientifique et opérationnelle de surveiller et d’exploiter ces milieux dans les années à venir ?
Câbles sous-marins : vecteurs de puissance
Autre levier de souveraineté identifié dans l’entretien : les câbles sous-marins. Invisibles mais omniprésents, ils assurent l’essentiel du trafic mondial de données – plus de 95 %, selon les estimations. Leur sécurisation, leur entretien et leur géolocalisation sont devenus des sujets hautement sensibles pour les États. Si l’Ifremer n’en assure pas la gestion directe, l’institut contribue, à travers ses travaux, à la compréhension des fonds marins dans lesquels ces câbles sont déployés.
L’innovation technologique joue ici un rôle clé. Les « smart cables », capables de capter des signaux sismiques ou des déformations du sol en temps réel, illustrent la convergence entre recherche scientifique, sécurité civile et renseignement stratégique. De tels outils pourraient, à terme, renforcer les capacités d’alerte et de surveillance dans des zones d’accès limité.
Lire aussi sur L’Essor de la Sécurité : Menaces hybrides : alerte maximale sur les secteurs stratégiques français
Face à cette complexité croissante, l’intelligence économique s’impose comme un outil de pilotage indispensable. Elle permet, selon Rigaud, « d’éclairer les choix stratégiques, d’identifier les vulnérabilités et de décrypter les rapports de force ». Loin de se limiter à l’analyse concurrentielle, elle contribue à forger une culture commune de la souveraineté, dans un domaine – le maritime profond – où la capacité d’anticipation devient un facteur différenciant.